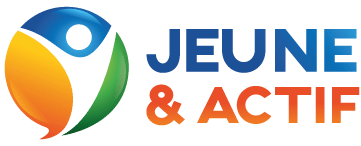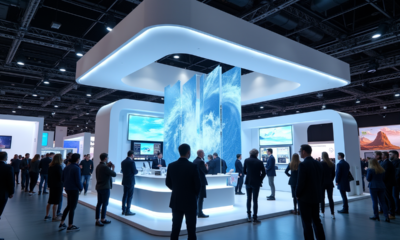Le GATT existe-t-il encore : histoire et évolution de l’accord général sur les tarifs douaniers
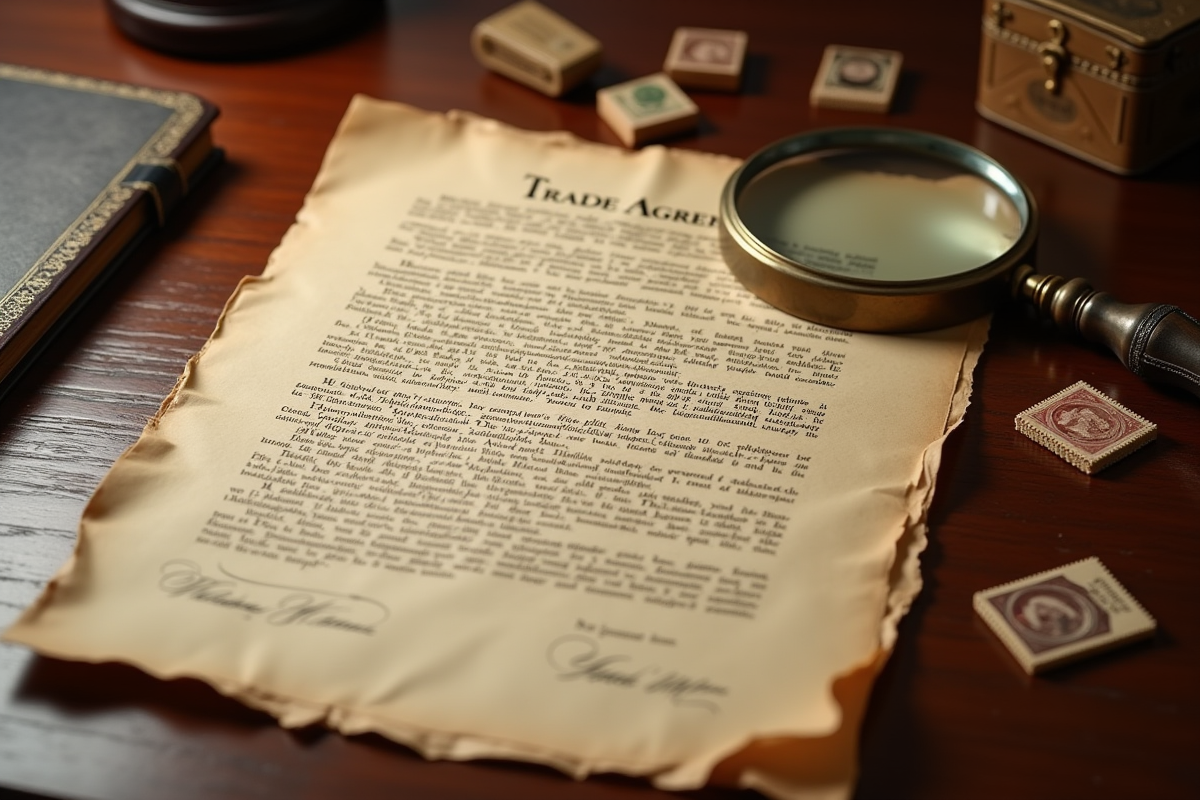
En 1947, les nations du monde, encore marquées par les ravages de la Seconde Guerre mondiale, se sont réunies pour signer l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). Cet accord visait à réduire les barrières commerciales et à stimuler la croissance économique mondiale. Au fil des décennies, le GATT a évolué pour s’adapter aux réalités changeantes du commerce international.
En 1995, une transformation majeure a eu lieu avec la création de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). L’OMC a absorbé et remplacé le GATT, tout en élargissant son champ d’action pour inclure non seulement les biens, mais aussi les services et la propriété intellectuelle. Aujourd’hui, bien que le GATT en tant que tel n’existe plus, ses principes et objectifs continuent de guider les échanges mondiaux à travers l’OMC.
A lire également : Devis signé ou bon de commande : quelle valeur juridique pour vos transactions ?
Plan de l'article
Les origines du GATT
En 1947, à Genève, vingt-trois pays ont signé l’accord fondateur du GATT. L’objectif était clair : réduire les barrières tarifaires et encourager les échanges internationaux. Ce premier accord a posé les bases d’un système de commerce multilatéral.
Principes directeurs
Le GATT s’est articulé autour de trois principes fondamentaux :
A lire également : Date de versement de la prime d'apprentissage : informations essentielles
- Non-discrimination : Les membres devaient accorder les mêmes conditions commerciales à tous les autres membres.
- Réduction des tarifs : Les négociations devaient viser à diminuer les droits de douane.
- Stabilité et transparence : Les règles devaient être claires pour éviter les surprises et les conflits.
Les cycles de négociations
Au fil des décennies, le GATT a orchestré plusieurs cycles de négociations, appelés ’rounds’, pour étendre et approfondir ses objectifs. Parmi les plus marquants :
- Le Kennedy Round (1964-1967) : Visait principalement des réductions tarifaires.
- Le Tokyo Round (1973-1979) : Introduisait des codes pour réduire les barrières non tarifaires.
- Le Uruguay Round (1986-1994) : Préparait la transition vers l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
Impact global
Grâce au GATT, le commerce mondial a connu une expansion sans précédent. Les échanges de biens ont vu leur volume augmenter de manière exponentielle, contribuant à la croissance économique globale et à la réduction de la pauvreté.
Le GATT a ainsi jeté les bases d’un système commercial plus équitable et prévisible, ouvrant la voie à l’OMC qui a pris le relais en 1995.
Les principes fondamentaux du GATT
Non-discrimination
Le principe central du GATT, la non-discrimination, repose sur deux piliers : la clause de la nation la plus favorisée (NPF) et le traitement national. La clause NPF exige que toute concession tarifaire accordée à un pays soit automatiquement étendue à tous les autres membres. Quant au traitement national, il impose que les produits étrangers bénéficient du même traitement que les produits nationaux une fois passés la frontière.
Réduction des tarifs douaniers
Une autre pierre angulaire du GATT réside dans la réduction des tarifs douaniers. Cette réduction s’opère par le biais de cycles de négociations multilatérales, visant à diminuer les droits de douane sur une large gamme de produits. L’objectif est de rendre les échanges plus fluides et moins coûteux, facilitant ainsi l’accès aux marchés étrangers pour les entreprises.
Stabilité et transparence
La stabilité et la transparence sont aussi au cœur du dispositif du GATT. Les membres doivent notifier toute modification de leurs politiques commerciales et s’engagent à ne pas introduire de nouvelles restrictions sans consultation préalable. Cette transparence permet de limiter les surprises et de créer un climat de confiance entre les partenaires commerciaux.
Traitement spécial et différencié
Le GATT reconnaît par ailleurs la nécessité de traitements spéciaux et différenciés pour les pays en développement. Ces derniers bénéficient de délais supplémentaires pour l’application des accords et de l’assistance technique pour faciliter leur intégration dans le système commercial mondial. Cette approche vise à réduire les disparités économiques et à encourager une croissance inclusive.
Les évolutions et cycles de négociations
Le GATT a traversé plusieurs cycles de négociations depuis sa création en 1947, chacun marqué par des avancées significatives dans la libéralisation du commerce mondial. Les premiers cycles, comme ceux de Genève (1947) et d’Annecy (1949), se sont concentrés sur la réduction des tarifs douaniers. Mais c’est lors du cycle de Dillon (1960-1961) que la dimension multilatérale a véritablement pris son essor.
Le cycle de Kennedy
Le cycle de Kennedy (1964-1967) a introduit des réductions tarifaires plus larges et a mis en place le premier accord anti-dumping, visant à protéger les marchés contre les pratiques commerciales déloyales. Cette étape a marqué une avancée dans la régulation du commerce mondial.
Le cycle de Tokyo
Le cycle de Tokyo (1973-1979) a élargi le champ d’action du GATT en incluant des accords sur les barrières non tarifaires, telles que les normes techniques et les subventions. Ces accords ont permis d’améliorer la transparence et de renforcer les disciplines commerciales.
Le cycle d’Uruguay
Le cycle d’Uruguay (1986-1994) a représenté une transformation majeure. En plus de réduire encore les tarifs, il a conduit à la création de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 1995, absorbant ainsi les fonctions et principes du GATT. Ce cycle a aussi introduit des règles sur les services, les droits de propriété intellectuelle et le règlement des différends.
Le GATT, en évoluant et en se transformant, a su s’adapter aux exigences croissantes du commerce mondial. Ses cycles de négociations ont permis de renforcer et d’élargir les bases sur lesquelles repose l’actuel système commercial multilatéral.
La transition vers l’OMC et l’héritage du GATT
Le passage du GATT à l’OMC en 1995 a marqué un tournant décisif dans l’histoire du commerce mondial. L’Organisation mondiale du commerce a succédé au GATT en intégrant non seulement les accords commerciaux existants mais aussi en élargissant son champ d’action.
Les nouvelles missions de l’OMC
L’OMC a introduit de nouvelles disciplines et a renforcé les anciennes. Parmi ses principales missions :
- Surveillance des accords commerciaux : L’OMC veille à ce que les accords soient respectés et applique des mécanismes de règlement des différends plus contraignants.
- Extension des domaines couverts : L’OMC inclut désormais les services, les investissements et la propriété intellectuelle, des domaines qui n’étaient pas ou peu traités par le GATT.
- Promotion de la transparence : Les membres doivent notifier leurs politiques commerciales, ce qui renforce la transparence et la prévisibilité des échanges.
Les défis contemporains
L’OMC hérite des défis du GATT mais en affronte aussi de nouveaux. La montée du protectionnisme, les tensions commerciales entre grandes puissances et les questions environnementales sont autant de sujets sur lesquels l’OMC doit se positionner.
L’héritage du GATT
L’influence du GATT demeure dans les principes fondamentaux qui régissent le commerce mondial. Les concepts de non-discrimination, de réduction des barrières tarifaires et de transparence restent au cœur des négociations commerciales actuelles.
L’OMC continue de porter l’héritage du GATT tout en s’adaptant aux nouvelles réalités économiques et géopolitiques. Les bases jetées par le GATT ont permis de construire un système commercial global plus intégré et plus complexe.
-
Marketingil y a 4 mois
Les meilleurs logiciels de business plan pour entrepreneurs
-
Servicesil y a 10 mois
Avantages de travailler avec un freelance et comment cela booste votre entreprise
-
Servicesil y a 10 mois
Logiciels CRM: sélection des meilleurs outils de gestion de la relation client
-
Servicesil y a 9 mois
Se réorienter professionnellement : comment choisir sa future ville d’étude ?